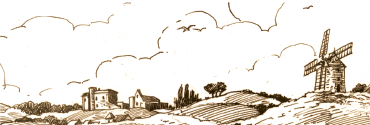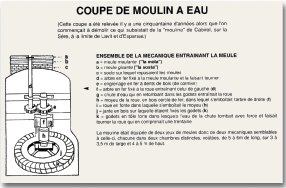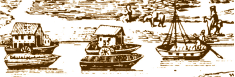|
LES ARTISANS DU VIVRE la meunerie
|
La Lomagne, terre à blé, connut très tôt le développement de la meunerie, utilisant deux sources d'énergie différentes : l'eau et le vent. Au début du XIXe siècle, on comptait en Lomagne une cinquantaine de moulins à eau et le double de moulins à vent. |
|
| LES MOULINS A EAU L'Arratz vient en tête des rivières avec une quinzaine de moulins, suivi par la Gimone (11) et l'Auroue (8). Le moulin enjambait le lit étroit des rivières, la chaussée qui retenait l'eau faisant usage de pont pour le desservir et permettant la liaison entre les deux rives, reliant les routes qui y aboutissaient.
LES MOULINS A NEF |
|
|

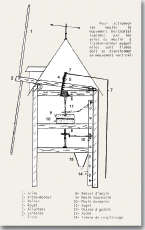 |
LES
MOULINS A VENT Bien que ses cours d'eau fussent bien équipés en moulins, la Lomagne était le pays des moulins à vent. Leur architecture consistait en une tour ronde en pierre ou en brique surmontée d'une toiture orientable portant les ailes. A l'opposé des ailes, le gouvernail, grosse barre de bois, servait à les diriger face au vent, manoeuvre assez pénible, aussi le meunier y attelait-il son mulet. Une fois les ailes orientées en fonction du vent dominant, on amarrait le gouvernail avec une grosse pierre. Lorsque le vent était faible, on tendait toute la voile ; lorsqu'il était plus fort, on la serrait un peu et s'il était trop violent, on la serrait tout à fait. Parfois, il fallait changer d'orientation plusieurs fois dans la même journée. |
|
| LE METIER DE MEUNIER La farine des moulins à eau était plus appréciée que celle des moulins à vent. Le débit de l'eau régularisé par la chaussée permettait une meilleure mouture qu'avec le vent qui changeait souvent et soufflait plus ou moins fort. S'il était faible il y avait davantage de son que de farine ce qui rendait le pain moins blanc ou bien il ne fallait sortir que 12 miches du sac au lieu de 15. Le meunier livrait le blé moulu, son et farine mélangés, car on le tamisait à la ferme. La même meule servait pour le blé et les autres grains : maïs, fèves, dont la farine entrait dans l'alimentation humaine. Pour se payer de son travail, le meunier prélevait " la punhèra " (la poignée) sur la mouture ou le grain, quantité qui équivalait généralement au cinquième. Seulement les meuniers ont toujours eu la réputation d'être des voleurs. |
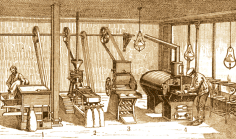 |
|
![]()